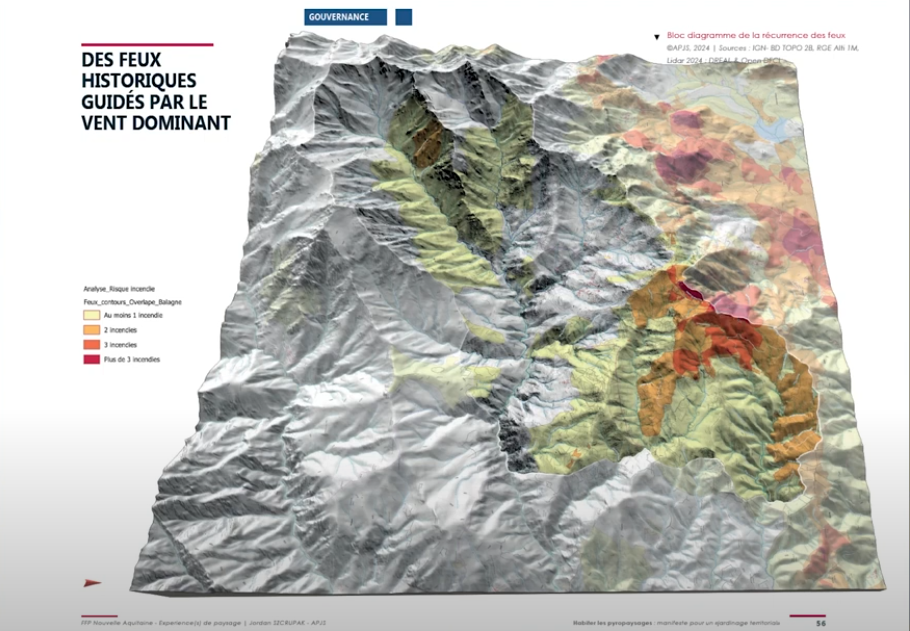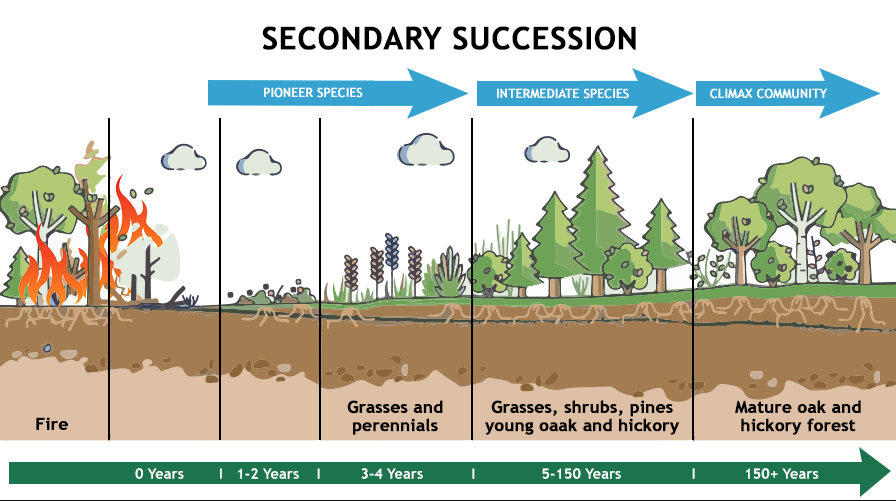A l’occastion du débat sur la loi Duplomb, la ministre de l’agriculture a affirmé que : “l’agriculture biologique est une agriculture de principe, incapable de nourrir le monde”. Le fait de suggérer que la faim et l’insécurité alimentaire seraient des problèmes agricoles est tout à fait problématique. La faim dans le monde est un problème politique. Dans ce domaine Me Genevard ferait mieux de regarder ce que fait son engeance, plutôt que d’essayer de faire peser sur les agriculteurs une responsabilité qui n’est pas la leur.
Il n’existe pas de pénurie alimentaire globale. Les problèmes d’accès à l’alimentation sont liés à :
- l’absence de régulation efficace des marchés agricoles et la spéculation sur les matières premières
- la mainmise de quelques multinationales
- le gaspillage : près d’un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée chaque année
- des décisions politiques absurdes
- les dictatures et les guerres
Prenons quelques exemples :
La crise alimentaire mondiale de 2007-2008 est causée par l’abandon des cultures vivrières, la spéculation sur les marchés, la hausse des prix de l’énergie et des fertilisants, et des restrictions à l’exportation décidées par certains États. Résultat : flambée des prix, émeutes de la faim, instabilité politique, chute de gouvernements.
La guerre en Ukraine a récemment illustré la vulnérabilité face aux chocs géopolitiques. La panique sur les marchés, la spéculation et la concentration du commerce céréalier entre quelques multinationales ont fait grimper les prix, privant les plus pauvres d’un accès à l’alimentation.
En Afghanistan, au Yémen, au Soudan du Sud ou encore à Gaza, les conflits armés détruisent les infrastructures, déplacent les populations et provoquent l’effondrement économique, rendant l’accès à la nourriture impossible pour des millions de personnes, même quand les récoltes ou à défaut l’aide internationale sont suffisantes.
En 2024, 32 % des Français se déclarent en situation d’insécurité alimentaire (58 % des 18-24 ans et 40 % des familles avec enfants). 28 % des familles déclarent avoir eu faim sans pouvoir manger au cours de l’année écoulés. 35 % des Français ont déclaré ne pas avoir mangé trois repas par jour pour des raisons financières au cours des deux dernières années.
La question n’est pas de choisir tel ou tel type d’agriculture. La faim dans le monde et en France résulte exclusivement de choix politiques, de conflits, d’inégalités, de gaspillage et d’un système commercial défaillant. Au lieu de s’enferrer dans des conflits qui n’ont pas lieu d’être, ramenons le débat sur une évaluation effective des politiques agricoles au regard de notre autonomie alimentaire et de la prospérité des campagnes et de ceux qui y vivent. Sujets qui sont au centre de notre travail de vulgarisation et de veille.