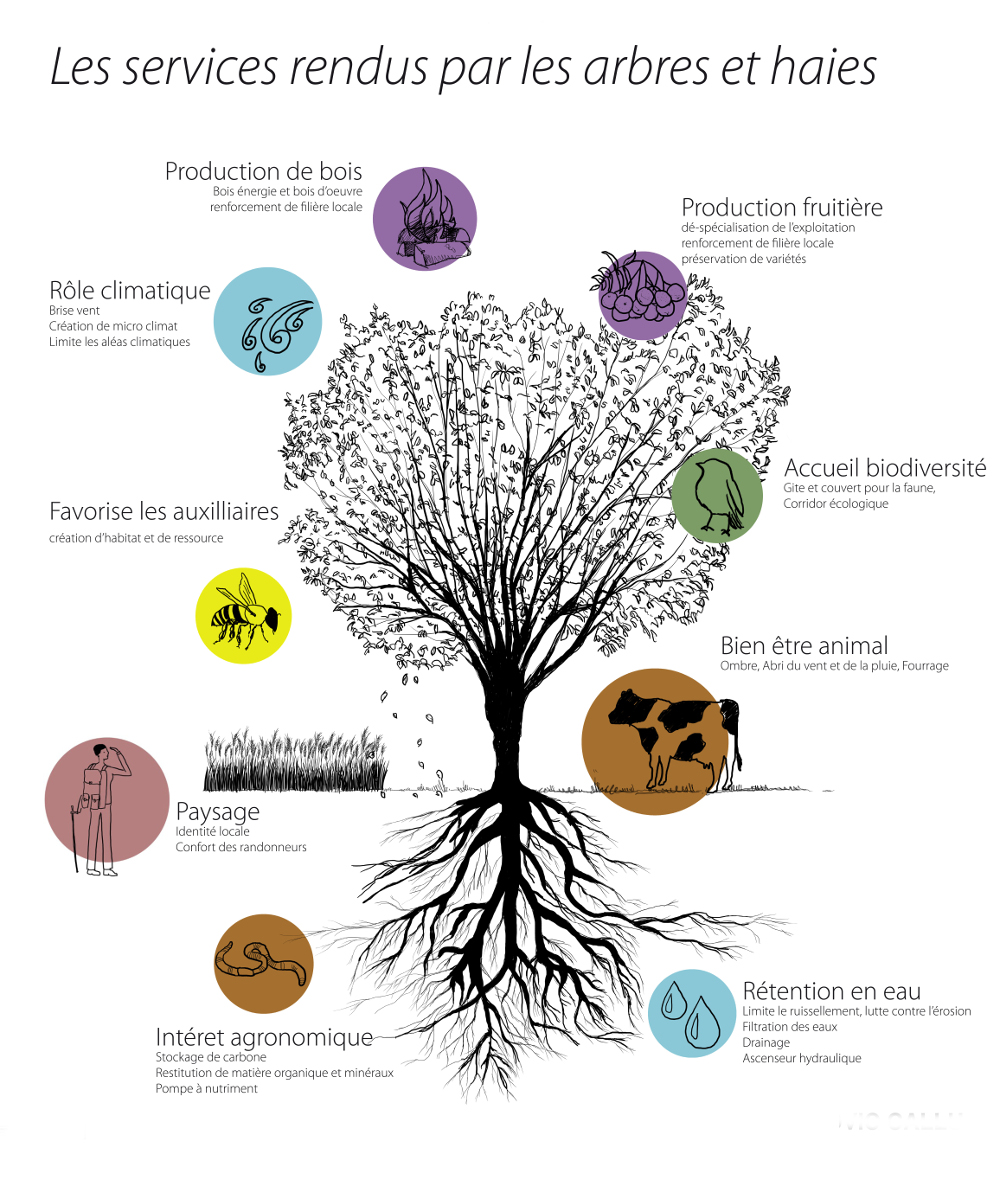Dans une synthèse de 2020 (https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2021/12/FRB-Synthe%CC%80se-plantations.pdf), la @Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) revient sur le projet de Grande muraille verte initié par le très charismatique président du Burkina Faso, Thomas Sankara, au milieu des années 80.

Suite aux grandes sécheresses qui ont sévi au Sahel dans les 60 et 70, une plantation continue de 7000 km d’arbres est lancée. Son but est de contrer l’avancée du désert.
Même si le désert n’avance pas vers le sud comme on pouvait le craindre, reverdir le Sahel reste un objectif important comme le souligne le GIEC dans ce rapport de 2022 (https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Chapter07.pdf page 74).
Mais ce projet a englouti des sommes faramineuses pour un résultat souvent décevant. Les arbres plantés ne sont pas adaptés, pas entretenus et meurent. Paradoxalement, seules les plantations à visée commerciale réussissent.
Cet échec à plusieurs causes. Notamment, le choix des essences souvent peu à même de survivre sans entretien. Mais c’est surtout le régime foncier et le statut de l’arbre qui sont les principaux obstacles. Par l’effet d’un reliquat du droit colonial, l’agriculteur n’est pas propriétaire des arbres sur les parcelles qu’il exploite. Sa présence n’est donc qu’une contrainte. C’est la levée de cet obstacle social qui permettra au projet de vraiment décoller.
Parallèlement, certains agriculteurs développent une forme d’agriculture originale, le Zaï, qui favorise la germination des graines d’arbres déjà présentes dans le sol. De cette conjonction de facteurs émergera la pratique du bocage sahélien qui fait le succès du verdissement du Sahel.
L’agronome australien Tony Rinaudo, à qui Arte a consacré un documentaire (The Forest Maker) a contribué à favoriser la diffusion de cette pratique oubliée dans les années 80. Il a commencé à appliquer cette pratique au Niger, après plusieurs années de vains efforts de reforestation. En impliquant les communautés villageoises, les résultats y ont été spectaculaires : « Dans les années de sécheresse, les récoltes étaient infiniment plus abondantes sous les arbres… Je ne sais pas comment le principe s’est disséminé, mais de paysan en paysan, le mot a circulé tant et si bien qu’en une vingtaine d’années, ce sont 200 millions d’arbres qui ont poussé au Niger, sans en planter un seul. »
Favoriser l’émergence de la végétation spontanée s’appelle la régénération naturelle spontanée. Cette approche permet de végétaliser les espaces solidement et à peu de frais, puisque c’est le stock de graines déjà en place qui va s’exprimer.
Mais ce que montre cette expérience c’est que si la régénération est spontanée, le démarrage du processus ne peut se faire que lorsque les conditions agronomiques et sociales sont réunies. Que seraient ces conditions dans la France d’aujourd’hui ? Nous essaierons dans de prochains post de le définir et de tracer un chemin pour y aboutir.